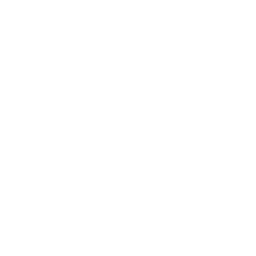Consentement dans les rencontres en milieu scolaire sur la vie relationnelle, affective et sexuelle - Atelier animé par William Gobet, partenaire éducatif, et Bruno Montel, CCF
1. Présentations
William Gobet a été éducateur spécialisé pour différents publics, puis chef de service. Il est partenaire éducatif indépendant depuis 8 ans.
Bruno Montel est CCF indépendant depuis 10 ans.
2. On entre dans le sujet
Pour William Gobet, on parle beaucoup du harcèlement des filles par les garçons . Mais quel regard ont les garçons ? Si on essayait d’en parler autrement avec un autre point de vue ? Comment on « drague », si le harcèlement est une mauvaise compréhension de la séduction ?
Restitution d’un sondage auprès de jeunes sur le sujet : un nombre important de garçons de 15 à 30 ans expriment une « peur de l’humiliation », trouvent que « les filles ont le pouvoir » et qu’elles « manipulent ».
Pour Bruno Montel, à propos du consentement dans les interventions en milieu scolaire :
- les différents types d’absence de consentement punis par la loi : injures, harcèlement, attouchement, viol ; mais aussi droit à l’image, monde numérique des réseaux sociaux (le numérique n’est pas un espace sans loi) ;
- l’absence de consentement commence par de « petites » choses : les stopper immédiatement, en trouvant les mots (je suis légitime) puis en allant chercher de l’aide auprès d’adultes, éventuellement de représentants de la loi ;
Exemple : ex-petit copain qui harcèle sur FB, rappelé immédiatement à la loi, par téléphone, par la policière ayant entendu la plainte.
La parole aux participant.e.s : un débat animé s’ensuit sur les stéréotypes de genre, hétéronormatifs, très (trop) présents dans cette présentation et dans l’éducation, au goût de certaines participantes, selon lesquelles le consentement s’inscrit dans une relation (amicale, amoureuse ou autre) entre deux personnes, quel que soit leur genre. Qu’en est-il de la parentalité ds garçons, surtout éduqués par leur mère ? Quel est la place de l’homme dans les couples d’aujourd’hui, où souvent la femme est contrôlante, puissante ? Que penser des ateliers où en effet les garçons déplorent que les filles aient le pouvoir, mais où les filles n’ont curieusement pas pris la parole ? N’est-il pas provoquant d’amener ces témoignages devant un public majoritairement féminin, et dans un contexte où les femmes sont majoritairement les victimes de la violence conjugale ?
Selon un psychologue présent, la grande question de l’adolescence, au-delà des rapports amoureux, est celle de sa place dans la monde. Une assistante sociale se demande pourquoi les interventions « mon corps c’est mon corps », courantes à une époque, ont quasiment disparu.
3. Lâcher de mots : à quoi vous fait penser « consentement » ?
4. Situations concrètes
Saynète 1 : William, éducateur, suit Bruno, 25 ans, depuis 2 ans. Il l’aperçoit par hasard en ville, parlant avec une jeune femme du même âge. Il semble plutôt dominant. Elle parait gênée, elle parle peu. William engage la conversation avec la jeune femme, pour s’assurer qu’elle est ok avec la situation. Bruno proteste, la jeune femme s’éclipse et Bruno est furieux.
Réaction des participant.e.s : pourquoi faut-il « protéger » cette jeune femme, comme William souhaite le faire dans son intervention ? Et si c’étaient 2 filles ?
Saynète 2 : A la fin d’une intervention en 3e, William, collégien, vient trouver Bruno, le CCF, pour le questionner sur une situation qu’il vit. Une camarade de classe lui fait des avances, il n’est pas intéressé mais ne sait comment le lui dire, de peur de la blesser mais aussi de ne pas « coller » à sa représentation selon laquelle « un gars devrait toujours être d’accord ». Le CCF l’amène à exprimer sa gêne et lui suggère une façon respectueuse d’exprimer ce qu’il souhaite.
Réaction des particpant.e.s : une femme se dit choquée par le placage de la représentation du CCF sur le ressenti du garçon ; il faut ouvrir le champ des possibles ; pour une autre, les interventions sont bloquées par les institutions (mairies, écoles elles-mêmes) ; pour une autre, les enfants sont demandeurs, c’est nous adultes qui sommes mal à l’aise : « nous sommes des êtres sexués, quand même, tous, ici ! ».